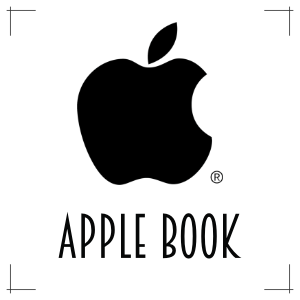PROLOGUE
___
Je me précipite dehors.
— Clothilde, attends ! crie ma mère.
— Je suis en retard !
— Tu dois…
Boum !
Je claque vigoureusement la porte de la demeure familiale et dévale les marches du perron. Je monte aussi vite que possible dans ma voiture, attitude téméraire et acrobatique quand il faut composer avec une longue jupe droite, des talons hauts et une Porsche aux sièges baquets. Je démarre et me garde bien de décrocher quand mon téléphone portable se met à carillonner. Je prétendrai ne pas avoir entendu la sonnerie.
En m’engageant sur la voie rapide, j’accélère. J’adore le ronronnement de mon bolide. Mon père me l’a offert pour mes vingt ans. Une folie dont ma mère ne s’est toujours pas remise et qu’elle me reproche.
Comme si cet achat avait pu compromettre les finances familiales !
Papa est PDG d’une grosse entreprise de cosmétiques et ma petite maman chérie, ex-miss France, se la coule douce à la maison depuis bien avant ma naissance. Je pousse les régimes, il n’y a jamais de radars dans ce secteur et 180 km/h, c’est une vitesse d’escargot pour cette merveille. Je préfère ne pas penser à ce qui se produira ce soir, quand ma mère sera là à m’attendre dans le canapé avec son air de dame patronnesse outragée, qu’elle va recommencer à me sermonner :
— Clothilde, tu dois aller rendre visite à ta grand-mère. Elle ne sera pas éternelle. Elle ne t’a pas vue depuis trois mois.
« Et alors ? » devrais-je me retenir de répondre.
Ma grand-mère est gentille, mais elle a quatre-vingt-cinq ans. Sa conversation se limite à ses géraniums, à ce que lui a dit sa voisine, à ce que son voisin plante dans son potager et à ses souvenirs de l’époque où mon héroïque grand-père, le vétéran décoré de la Deuxième Guerre mondiale, était encore parmi nous. Une vie entière à la campagne, ça laisse des traces sur l’ouverture d’esprit et le nombre de centres d’intérêt. Maman ne veut pas comprendre à quel point je m’ennuie là-bas. Elle voit toujours la maison de son enfance comme le paradis sur terre, alors qu’en réalité, il s’agit d’une vieille bicoque où les fenêtres sont des passoires thermiques et où seul un miracle fait que le toit ne fuit pas plus souvent.
Autrefois, j’aimais aller jouer dans le jardin et me faire dorloter par les amis et voisins de papy et mamie qui trouvaient la petite Clothilde trop mignonne. Seulement, j’ai passé l’âge de grimper dans les pommiers. Donc à part écouter ma grand-mère radoter en buvant du mauvais café lyophilisé, il n’y a rien pour moi. À tout cela, il faut ajouter les trois heures de trajet, dont la moitié sur des routes départementales qui mettent à la torture les suspensions de ma voiture et, une fois sur place, l’absence de réseau qui coupe toute communication avec le monde civilisé.
La sortie de l’autoroute s’annonce enfin. La Porsche slalome avec aisance autour du rond-point. Sa puissance me permet de doubler les traînards qui encombrent la chaussée. Feu rouge !
Je vais vraiment être en retard cette fois.
Pianotant sur le volant en cuir, je commence à m’énerver. Je suis obligée de klaxonner le caramel mou devant moi qui lambine à redémarrer. La chance n’est définitivement pas de mon côté : cinq cents mètres plus loin, c’est le passage à niveau qui se ferme.
— Je suis maudite !
J’ai hurlé tellement fort que ma voix a couvert la musique que le système audio haut de gamme déverse dans l’habitacle. Je suis en route pour le brunch de printemps de mon club de golf. Cette année, j’ai été élue « Reine du club ». C’est un titre ridicule, un peu comme celui de Miss France, mais il permettra de rencontrer beaucoup de monde – du « beau » monde –, pour me constituer un carnet d’adresses et un bon réseau pour le futur. Il faut absolument que je sois à l’heure pour les photos avec les dirigeants, mais aussi avec les joueurs professionnels qui ont fait le déplacement pour le master série. Ils drainent dans leur sillage leurs groupies – aucun intérêt – et leurs sponsors qui eux sont ma cible pour préparer mon avenir.
Je ne peux retenir un sourire sarcastique à la pensée de la tête que va faire cette pimbêche d’Anne-Cécile, cette gourde qui espérait que l’argent de son paternel – patron d’une entreprise d’armements à la réputation douteuse –, ainsi que sa propension à écarter les cuisses lui permettraient de tout obtenir dans la vie sans jamais se servir de la masse spongieuse et indéterminée qu’elle a entre les oreilles. Pour l’élection, cette bécasse s’est même fait refaire le nez et regonfler les seins ! À 23 ans, j’ai la chance d’avoir une beauté naturelle que je tiens de ma mère – merci l’ADN –, un petit charme piquant et drôle qui me vient de mon père.
Mieux encore, j’ai réussi haut la main mes examens de master en communication et marketing. Grâce aux relations de ma famille, dès septembre, je commencerai le job de mes rêves dans une prestigieuse boîte d’événementiel à Paris. Avant, j’ai l’intention de partir me délasser trois semaines aux Maldives avec mes amis de promotion.
Nouveau virage serré. Rétrogradage, reprise d’accélération. En lançant la voiture à l’assaut de la nationale, je réfléchis à tout ce qu’il me faudra faire en rentrant de vacances. D’abord vider ma chambre à la maison, et ensuite faire comprendre à mes parents qu’il n’est plus question que je passe un week-end sur deux chez eux.
Cette fois, c’est l’émancipation, maman devra me lâcher.
Je dois aussi embaucher un décorateur. Le look étudiant de mon loft ne convient plus à mon statut. J’ai besoin de quelque chose de plus adulte, de plus classe. Ma garde-robe va d’ailleurs subir la même transformation. Pour organiser des soirées réussies avec mes nouveaux collègues, tous des habitués de la vie nocturne parisienne, tout devra être à la hauteur de mes ambitions. Plus que quatre kilomètres… et cinq minutes avant d’être officiellement en retard. J’engage la Porsche dans l’avenue. De loin, je vois un attroupement.
Zut, la sortie de l’école !
Au lieu de ralentir, je klaxonne pour signaler mon approche rapide. Ces ménagères et leurs marmailles vont bien comprendre. Elles vont se pousser. Tout arrive vite… très vite… trop vite…
L’enfant surgit d’entre deux véhicules. Je donne un coup de volant en écrasant le frein. Je veux de toutes mes forces l’éviter, mais le bruit du petit corps heurtant la carrosserie est terrible. En une seconde, je me dis que je dois m’arrêter, mais que je n’ai pas le temps, et surtout, que je n’ai pas envie d’assumer ma monstrueuse responsabilité. Le destin règle mon dilemme.
Ma voiture est partie en glissade et la route est mouillée. Malgré un contre-braquage désespéré et une reprise d’accélération, mon bolide s’encastre dans un fracas de métal hurlant et de verre désintégré contre le bus scolaire garé le long du trottoir. L’airbag m’explose à la figure. Une douleur atroce transperce mon corps. Je perds conscience.
___
Chapitre 1
___
La sensation est horrible. La douleur me lamine le flanc droit. Elle irradie tout le long de ma colonne vertébrale, rayonne dans mes côtes. Mes poumons sont sous la pression du volant qui m’enfonce la poitrine et me comprime le cœur. J’ai un goût de terre âcre dans la bouche qui me retourne l’estomac, me donne envie de vomir. Une torture. Un avant-goût de l’enfer.
Je viens d’avoir un accident, est ma première pensée.
J’ai tué un enfant ! la seconde.
Cette idée est si insupportable que je veux mourir pour me punir. Je voudrais pleurer, demander pardon, mais à qui ?
À ce pauvre petit ou est-ce une fillette ?
Je ne le saurai peut-être jamais. La culpabilité m’étouffe. J’essaie de tousser. Je suffoque. La douleur s’accentue comme le chatoiement des flammes d’un incendie qui se nourrit de ce qu’il détruit. J’ai la sensation d’être consciente, mais je ne peux pas bouger. Je sens mon corps, mais tout est bloqué par cette souffrance. Je n’ai plus le contrôle.
J’ai tué un enfant !
Je suis une meurtrière…
Un violent vertige me prend, me saisit à la gorge, démultipliant mon envie de vomir. Je tire du cou. Soudain, j’ai l’impression d’être soulevée, je décolle, je vole !
Peut-être suis-je en train de perdre conscience une nouvelle fois ?
La douleur est toujours là, lourde, sourde, griffant chaque nerf, charriée même dans le flux de mes veines. Brusquement, je cesse de planer. Je tombe, attirée vers le bas par une force incroyable. Je sombre dans un précipice où la chaleur et la souffrance sont de plus en plus intenses, se fondent l’une en l’autre dans une sensation d’implosion de chacun des plus infimes atomes de mon être.
Les flammes de l’enfer ? me dis-je dans un élan mystique.
Mon corps voudrait hurler, mais aucun son ne sort de ma bouche.
Tuez-moi, mais sauvez l’enfant… Je Vous en prie. Sauvez l’enfant !
Cette supplique, je l’adresse aux limites de l’inconscience à un Dieu en qui j’ai toujours prétendu ne pas croire. Tout aussi vite que je suis tombée, je repars vers le haut, dans un ascenseur fou qui chavire mon esprit. La chaleur disparaît. Un froid glacial me saisit, partant du cœur, se répand dans mes entrailles, dans tout mon être, anesthésiant la douleur qui me submergeait à m’en faire perdre la raison.
De nouveau lucide, j’entends un bruissement d’ailes, comme le froufrou soyeux de celles des grands rapaces. Une lueur blanche, terrifiante de pureté m’aveugle malgré mes paupières closes. Elle me fait mal, exacerbant ma culpabilité, mon envie de mourir pour expier ma faute.
Je fais le yoyo. Ils ne savent pas s’ils m’envoient en enfer ou au paradis. Papa, maman, mamie, je vous aime tant. Oh, maman, tu l’avais dit : cette voiture est dangereuse. J’ai tué un enfant… Pardon… Pardonnez-moi tous…
— Ouille…
Ma conscience s’éveille au son de ma voix. Pourtant, cela n’a guère été qu’un pauvre murmure rauque et éraillé sortit de ma gorge en feu. Un gémissement suit. J’ai mal, affreusement mal… partout. J’ai la sensation d’être passé sous un camion. Ma mémoire se réveille.
En fait, je me suis pris un bus de plein fouet.
Et j’ai tué un enfant la seconde d’avant ! Un hoquet m’échappe dans un raclement douloureux sur mes cordes vocales, alors que des sanglots menacent de m’étouffer. La culpabilité me tombe dessus comme une chape de plomb.
Mourir, c’est tout ce que je mérite.
Il faut plusieurs essais à mon corps, qui veut vivre, pour reprendre sa respiration. Avec le retour de l’oxygène dans mon cerveau, je retrouve un semblant de lucidité. Prudemment, je tente de bouger et, à ma grande surprise, mes doigts répondent, mes poignets et mes orteils aussi. Chaque muscle, chaque articulation me fait mal. J’ai la sensation que ma boîte crânienne est trop petite et que ma cervelle va exploser. Sans réfléchir, je roule sur le côté.
Un nouveau gémissement de douleur, long, plaintif, résonne à mes oreilles. Il me faut deux secondes pour comprendre que c’est de ma gorge brûlante qu’il est sorti. Je bouge très lentement : ce serait idiot que je tombe si je suis sur un lit d’hôpital comme cela m’est arrivé à huit ans, après mon opération de l’appendicite – un bras cassé, deux mois plâtré. Rien ne se produit. Étonnée, je me rends compte qu’il n’y a aucun bruit autour de moi. Juste un silence assourdissant.
Peut-être est-ce la nuit ?
Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir, de découvrir où je suis et de faire face aux conséquences de mes actes. Je regroupe les lambeaux de mon courage et j’essaie d’ouvrir les paupières. Impossible.
Maladroitement, je lève la main. Aucune entrave n’a retenu mon geste. Je n’ai donc pas de perfusion. Je me frotte les yeux. La sensation est étrange : c’est comme si j’avais du sable sur le visage et que les grains roulent sous mes doigts.
Se pourrait-il que je sois encore dans l’épave de la voiture ?
Dans ce cas, pourquoi je n’entends pas les sirènes des pompiers ou de la police ? Je flotte dans la confusion la plus totale. Arc-boutant ma volonté, je réussis enfin à forcer mes paupières à se décoller dans un arrachement douloureux de cils. Et là, l’univers rationnel entre en collision avec ce que je vois.
Je suis en train de buguer…
Mes yeux me disent que je me trouve dans un endroit sombre, inquiétant et que, si je suis si mal, c’est parce que je suis couchée par terre. Mon esprit baigne dans un brouillard épais, j’en viens à me demander si je peux faire confiance à mes perceptions, si je ne suis pas en plein délire. J’essaie de me concentrer. Ma tête tourne. Je n’arrive pas à fixer mon attention.
Respire… comme au yoga. Lentement.
Il me faut de longues minutes avant que mon cerveau ne réussisse à analyser les images qui lui parviennent et cette fois, je me sens définitivement perdue. C’est incompréhensible. Je referme les yeux pour tenter de me raisonner. Je serre les paupières à m’en faire mal, me prenant la tête entre les mains pour comprimer mes tempes et empêcher ma cervelle d’imploser. Instinctivement, je me roule en boule.
Brutalement, les souvenirs de l’accident, du bruit abominable de métal froissé, de l’explosion des airbags et de la douleur atroce dans ma poitrine m’assaillent, mais ce n’est rien à côté de la culpabilité d’avoir tué un enfant qui me submerge jusqu’à me faire suffoquer de nouveau.
Je veux mourir.
J’ai assassiné un être innocent parce que j’étais trop pressée pour être prudente, trop imbue de ma petite personne pour prêter attention à ceux qui m’entouraient. Des larmes amères coulent sur mes joues, entraînant avec elles le sable qui m’irritait les yeux, me soulageant de cette souffrance, bien minime au regard de l’autre. Il faut un long moment pour que la crise passe, me laissant brûlante de honte, de remords. J’ai beaucoup de mal à reprendre le contrôle de la ronde infernale de mes pensées.
Le côté rationnel de mon esprit, mon disque dur interne, tente un reset, une remise en marche pour comprendre la situation. J’ai la conviction absolue d’avoir eu un accident de voiture. Ça, je le sais comme je connais mon nom, celui de mes parents et ma taille de soutien-gorge. Toujours cernée par un silence inquiétant, je m’oblige à rouvrir les yeux. Cette fois, mes paupières se décollent sans trop de difficultés, même si elles sont gonflées par les larmes. Le décor n’a pas changé. Je ne suis plus dans ma voiture ni dans le fossé, ni même dans une ambulance. Je ne suis pas non plus dans un hôpital ou alors c’est le modèle film d’horreur. Je suis allongée par terre. Sur des dalles glaciales. Sous un énorme escalier de pierre. Une idée idiote me traverse la tête :
On croirait la chambre d’Harry Potter en version médiévale, froide, obscure et humide.
Error! Hard disk failure…
Un instant, j’envisage de lâcher prise et de me laisser couler dans la folie, mais je me contrains à me ressaisir, serrant les poings à m’en blesser avec mes ongles. Ce n’est pas le moment que je divague, je dois me battre, reprendre le contrôle. Regroupant le peu d’énergie que contiennent mes pauvres muscles endoloris, je parviens à me redresser. J’ai à peine la place de m’asseoir sans me cogner. Le monde autour de moi tangue dangereusement. Je me rattrape en plaquant mes deux mains sur les murs.
Ils sont en pierre eux aussi, froids, légèrement humides. L’escalier au-dessus de moi doit être monumental et faire plus de quatre ou cinq mètres de large. Je suis tout au fond d’un petit espace sous les premières marches. Une cloison de briques me bloque l’accès de la zone où je pourrais me tenir debout.
— Qu’est-ce que je fais là ?
J’ai parlé à haute voix pour entendre un son humain, et accessoirement pour me prouver que je ne suis ni folle ni morte. Plusieurs minutes s’écoulent avant que je ne reprenne suffisamment de force pour envisager d’autres mouvements. Péniblement, je me mets à quatre pattes. J’incline la tête vers le sol pour essayer de contrôler les vertiges, mais je manque de me provoquer une nausée.
Ne pas vomir…
Redressant doucement mon visage pour tenter de trouver la bonne hauteur entre les deux maux, je serre les dents face aux élancements qui parcourent chacune de mes articulations, chaque muscle de mon corps. Je progresse lentement vers la sortie de ce trou à rats.
— J’hallucine !
Ma voix résonne contre les murailles, me revient en écho. Je suis tellement saisie par ce que je voie que je retombe sur le derrière, sans force.
— Ce n’est pas possible… C’est quoi ce délire ?
Un frisson, autant de froid que de peur me transperce. Devant moi s’étend une immense pièce sombre, soutenue par des colonnes en pierre brute. Le plafond, tout en voûtes, me fait penser à la grande salle médiévale de la Conciergerie, à Paris. Cet endroit doit mesurer plusieurs centaines de mètres carrés.
Sur le sol : de la paille.
Aux murs : des têtes d’animaux empaillés.
Le lieu est dénué de toute fenêtre.
Au centre, il n’y a qu’une longue table de bois portant six candélabres aux bougies allumées.
Il y a également des flambées dans cinq énormes cheminées.
Grâce à cet éclairage, un brin glauque et angoissant, je distingue trois autres âtres éteints. Malheureusement, la luminosité est si faible qu’il m’est impossible de voir ou même de deviner ce qui pourrait se dissimuler dans les recoins. L’ambiance est sombre, glaciale, totalement… médiévale dans ce que ce mot a de moins civilisé.
— Lugubre.
Je n’ai pas pu m’empêcher de marmonner malgré la peur qui monte en moi. Je me frotte aussi énergiquement que possible les bras pour me rassurer et me réchauffer. Le froid des pierres sur lesquelles je suis assise est en train de s’infiltrer dans mes vêtements et de se communiquer à mon corps. J’hésite pourtant à prendre le risque de me lever. Je n’ai pas confiance en la solidité de mes jambes et si je tombe, outre que j’ai toutes les chances de me fracasser le crâne, personne ne viendra à mon secours. L’endroit, désespérément silencieux, paraît être désert.
— Il vaut mieux que je me gèle les fesses.
Si cela me fait du bien de m’entendre, d’instinct, j’ai parlé très bas. Bizarrement, mes mots résonnent dans l’immensité de la salle, ricochant contre les murs épais, en écho, plus qu’ils ne l’auraient dû, déclenchant en moi un sentiment d’alerte.
Je ne dois plus parler à haute voix. Danger, danger, danger…
Le leitmotiv tourne encore dans ma tête lorsque je perçois subitement une cavalcade provenant d’un des nombreux couloirs que je devine déboucher sur cet endroit inquiétant. Sans me poser de question, j’obéis à l’injonction de mon instinct de survie, celui qui est niché au creux de mon estomac et dont j’ignorais l’existence jusqu’à cette seconde. Avec une vivacité que je ne pensais pas avoir, je recule toujours à quatre pattes pour retourner me réfugier dans la niche sous l’escalier. Je me recroqueville tout au fond de mon trou alors que le raffut devient de plus en plus fort. Tremblante de peur, je tente de contrôler ma respiration pour faire le moins de bruit possible, serrant les mâchoires et les maintenant de force avec mes mains pour empêcher mes dents de claquer.
Soudain, passe en courant devant la sortie de mon refuge, une paire de sabots et le bas d’un pantalon effiloché. L’être qui les porte bifurque et se retrouve un instant dans l’axe de l’ouverture, ce qui me permet de le distinguer en entier. C’est un homme qui ressemble à un paysan du Moyen Âge tels qu’ils sont représentés dans les reconstitutions historiques. Il arbore un froc de grosse toile marron, une chemise plus claire, et un truc tricoté sur les épaules qui doit être un gilet, enfin au niveau du concept parce que cela a surtout l’air d’une loque. « Je me disais qu’il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles, merci Thérèse. »
Zut, j’ai encore bugué.
J’essaie de me reconcentrer, mais j’ai du mal. Mon esprit logique peine à assimiler, car rien n’est cohérent. Je suis en perte totale de repères. Je tente à nouveau de fixer mon attention sur l’homme qui court et qui porte aussi un drôle de bonnet ainsi qu’une barbe hirsute. Pour autant que je puisse en juger à cette distance, il est hors d’haleine et au bord de la panique. Dans les secondes suivantes, ce n’est pas moins de dix paires de jambes qui passent à sa poursuite devant ma cachette.
Poussée par une dangereuse curiosité, je m’avance un petit peu pour mieux voir, veillant à ne pas sortir de la protection de l’ombre de l’escalier. Ces hommes – aucune femme – sont tous vêtus avec le même genre de guenilles. Leurs cris résonnent sous les voûtes et je ne comprends rien à ce qu’ils brament, mais leurs hurlements me font mal au crâne.
Le premier, qui est clairement la proie, contourne l’extrémité de la table, jette un coup d’œil par-dessus son épaule. Ses assaillants étant sur le point de le rattraper, il lance le sac qu’il porte en bandoulière le plus loin possible de lui, dans la direction opposée à celle de sa fuite. Puis, il détale comme un lapin et disparaît par une porte que je n’avais pas remarquée. L’effet de l’abandon de la besace est immédiat : la chasse s’interrompt. Tous ses poursuivants se ruent dessus. Un combat incroyable de férocité et de sauvagerie se déclenche entre eux pour s’en approprier le contenu. Les hurlements se font encore plus terribles, se répercutent contre les murs, m’assourdissent.
Je ne parviens pas à saisir ce qu’ils disent à cause de la résonance infernale, mais les hommes échangent des coups, ils se battent pour de la nourriture. Terrorisée par cette violence hallucinante, je recule au plus profond de mon trou. Ma main rencontre un tissu rugueux. J’en parcours les contours : c’est une besace du même genre que celle dont le fuyard s’est débarrassé.
À tâtons, veillant à ne pas faire de bruit – précaution inutile avec le raffut que font les autres sauvages –, j’en explore l’intérieur alors que, à quelques mètres de moi, la bataille se poursuit pour les dernières miettes. Mes doigts se referment sur une cuillère en bois, puis sur une timbale et une assiette en métal. Enfin, tout au fond, je trouve un morceau de papier roulé en tube.
Un parchemin… peut-être ?
Il faudra que je vérifie dès que j’aurai assez de lumière. La curiosité me taraude, mais pas question de bouger de ma cachette tant que les barbares sont dans la grande salle. Dieu seul sait ce qu’ils pourraient faire à une femme quand je vois ce dont ils sont capables pour une miche de pain… alors pour deux miches.
Très fin comme jeu de mots !
Je me fais honte. Comment mon cerveau peut-il songer à des trucs aussi idiots dans de pareilles circonstances ? Je ne tourne pas rond. Mon processeur a pris un sérieux coup.
Je délire, c’est officiel.
Décidant que la prudence est une vertu, je remise toute forme de curiosité et je m’assois, prête à attendre le temps qu’il faudra, le dos appuyé au mur, bien cachée dans ma tanière.
Pourvu que je n’éternue pas ! pensé-je soudain en sentant le froid s’insinuer de nouveau dans mes vêtements.
Les cris et les exclamations recommencent de plus belle. Le groupe d’hommes se remet à courir, repartant aussi vite qu’il est arrivé en une cavalcade effrénée, ponctuée de hurlements, dans le vacarme assourdissant des sabots qui heurtent le dallage de pierre. Un instant, j’ai l’impression de saisir le mot « viande » dans la cacophonie, mais sans en avoir la certitude. En quelques secondes, ils ont tous disparu, engloutis par un couloir et tout redevient silencieux. Il ne reste que l’odeur des bougies, celle du pain que le sac a contenu et celle du moisi qui empuantit la pièce elle-même.
Je respire mieux. Mon esprit logique vient de trouver la clé de l’énigme du spectacle complètement irréel auquel j’ai assisté.
Je suis à l’hôpital et j’ai des hallucinations à cause de la morphine ! J’ai juste à attendre de me réveiller.
A suivre…
Disponible e-book, broché, abonnement Kindle et Kobo+
Rejoindre mon club !

Les avantages du club ?
C’est un email tous les quinze jours avec toutes les annonces en avant-première, régulièrement des bonus lecture gratuits et l’accès à des concours exclusifs…
Pour te remercier de ton inscription, tu recevras un roman inédit : Voleur de mon Cœur !
Si tu préfères juste recevoir un seul mail par mois, tu peux choisir de t’abonner uniquement à la Newsletter du blog de ce site, en bas de page.